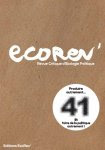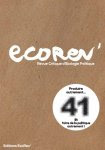Pour vous procurer ce numÃro
rendez-vous ici.
Edito
LâÃcologie politique possÃde quelques positions bien assises : il est devenu Ãvident au yeux de toutes et tous que le mode de production capitaliste, dÃsormais installà au niveau mondial, ne peut se perpÃtuer quâau prix dâun Ãpuisement des ressources de la planÃte et dâune marchandisation sans frein de lâactività humaine. De mÃme, nous sommes toujours plus a Ãtre convaincus que le productivisme à outrance, la recherche du profit maximum, lâobsolescence programmÃe ou encore la publicità ne sont pas des fatalitÃs, puisque dÃmonstration est faite en de nombreux points de la planÃte quâil est dâores et dÃjà possible de produire, de faire, voire mÃme de vivre autrement.
Un exemple dâactualità vient cependant sÃrieusement tempÃrer ces certitudes, celui de la Bretagne. Depuis plusieurs dÃcennies maintenant, cette rÃgion a tournà le dos à son large front de mer pour vivre repliÃe vers lâintÃrieur sur lâindustrie agro-alimentaire et lâÃlevage intensif. RelayÃe à Bruxelles par les lobbies productivistes, la Bretagne vit ainsi sous perfusion de subventions de la PAC. Zone dâactività enclavÃe  au bout du bout  du continent europÃen, ultra-spÃcialisÃe, elle nâa dâautre choix que dâentrer dans le systÃme communautaire de libre-Ãchange au prix dâun coÃt exorbitant au plan Ãcologique. En effet, si la Bretagne produit des porcs à foison, lÂAllemagne dispose en revanche dÂun avantage comparatif dÃcisif en matiÃre dÂabattage. DÃs lors ce sont plus de 700 000 animaux qui font chaque annÃe leur dernier voyage Outre-Rhin, au dÃtriment de toute prise en compte des impÃratifs Ãcologiques et à la faveur dâun dumping social qui ne dit pas son nom. De mÃme, la production de poulets, qui sâest dÃveloppÃe massivement en se destinant en grande partie à lÂexportation, vient concurrencer la production des pays les plus pauvres, au point de participer à une nouvelle forme de colonisation. Travailler dans un abattoir industriel, câest Ãtre condamnÃ, compte tenu de la concurrence des pays à bas salaires, à vivre une vie de misÃre et en mauvaise santà dans un espace polluà ici comme ailleurs ! Un processus que lâon retrouve, entre autres, dans la filiÃre textile, dont la catastrophe rÃcente du Rana Plaza au Bangladesh est une illustration flagrante, des plus macabres.
Si lâaffaire de lâÃcotaxe (pÃage routier) et la rÃvolte fiscale qui lâaccompagne en Bretagne, rappellent une fois encore que les problÃmes sont parfaitement identifiÃs, elles rÃvÃlent aussi une limite sÃrieuse du discours de lâÃcologie politique sur la maniÃre de penser le politique, a fortiori de faire de la politique. Sans doute, la politique passe-t-elle par la production de quelques idÃes, la promotion de quelques modÃles, la suggestion de quelques pistes de rÃformes comme les contributeurs de ce numÃro ont essayà de le faire, ce dont nous les remercions chaleureusement.
In fine, cela dÃmontre à combien la transition Ãcologique est bien peu de chose sans une  transition politique  qui lui est intimement liÃe. Le mouvement des  bonnets rouges  souligne à cet Ãgard les difficultÃs dâapprÃhender cette question avec nos catÃgories de pensÃe traditionnelles. Est-ce un mouvement populiste, identitaire et rÃactionnaire ? Est-ce lâamorce dâun sÃparatisme à lâimage des luttes engagÃes il y a de nombreuses annÃes dÃjà en Catalogne, au pays Basque, ou en Belgique ? Est-ce une rÃvolte contre la fiscalità et lâÃtat franÃais ou la marque dâune incapacità de lâUE à organiser la solidarità entre rÃgions riches et pauvres de lâEurope ? Probablement un peu de tout cela à la fois. On pourrait ainsi multiplier les interrogations tÃmoignant que la politique ne peut se rÃduire à la participation (ou non) à un gouvernement quel quâil soit, mais relÃve de mille et une dimensions (locale, rÃgionale, nationale, europÃenne, etc.), de mille et une questions (Ãconomique, politique, culturelle, etc.) qui dÃpassent et de loin, cette approche obsolÃte du pouvoir et de la politique, de lâÃtat et de ses institutions.
Ce numÃro 41 dâEcoRevâ se veut donc Ãtre une Ãtape sur le (long) chemin dâune rÃflexion cherchant à repenser les grandes questions de lâÃcologie politique à lâaune des rapports de pouvoir, des processus dÃmocratiques dâorganisation et de gestion des dÃcisions, de la gestion des institutions ou encore de lâ_expression_ des intÃrÃts. Ce sont là des thÃmatiques que lâÃcologie politique devra, tÃt ou tard, prendre à bras le corps si elle veut que la  transition Ãcologique  ne soit pas quâ une  belle idÃe  et si elle veut Ãgalement, dans la continuità historique des mouvement syndicaux et sociaux, remporter la bataille qui a toujours Ãtà la sienne : celle pour lâÃmancipation.
Produire autrement...
Et faire de la politique autrement !
Dossier coordonnà par Emmanuel Dessendier & Anita Rozenholc
![-]() p. 2 - Ãditorial
p. 2 - Ãditorial
La rÃdaction
![-]() p. 5 - Classique : Notes de voyage en Ãcosocialisme
p. 5 - Classique : Notes de voyage en Ãcosocialisme
JoÃl de Rosnay
![-]() p. 14 - Encart : Sources et ressources de lâÃcosocialisme
p. 14 - Encart : Sources et ressources de lâÃcosocialisme
Michael LÃwy
Dossier
![-]() p. 17 - Un premier pas vers un changement radical de mode de production
p. 17 - Un premier pas vers un changement radical de mode de production
Emmanuel Dessendier & Anita Rozenholc
![-]() p. 28 - Encart : LâÃcole des compÃtences : en sortir ?
p. 28 - Encart : LâÃcole des compÃtences : en sortir ?
AngÃlique del Rey
![-]() p. 32 - Quelles stratÃgies politiques de transition pour la gÃnÃralisation de lâÃconomie contributive
p. 32 - Quelles stratÃgies politiques de transition pour la gÃnÃralisation de lâÃconomie contributive
Michel Bauwens
![-]() p. 40 - Politique de la coopÃration
p. 40 - Politique de la coopÃration
Patrick Dieuaide
![-]() p. 45 - Une autre vie est possible : Ã propos du possible et de lâimpossible
p. 45 - Une autre vie est possible : Ã propos du possible et de lâimpossible
Joana Conill
![-]() p. 56 - Civiliser la croissance : sortir de la crise par le haut
p. 56 - Civiliser la croissance : sortir de la crise par le haut
Dominique MÃda
![-]() p. 64 - Pour une transition industrielle aux mains des salariÃs
p. 64 - Pour une transition industrielle aux mains des salariÃs
Evelyne Perrin
![-]() p. 73 - Une politique industrielle de rupture au temps de lâAnthropocÃne
p. 73 - Une politique industrielle de rupture au temps de lâAnthropocÃne
JÃrÃme Gleizes & Emmanuel Dessendier
![-]() p. 83 - De lâÃchec soviÃtique à la conversion Ãcologique
p. 83 - De lâÃchec soviÃtique à la conversion Ãcologique
Pierre Delorme
![-]() p. 99 - RÃconcilier emploi et environnement, sortir des dÃbats dâun autre temps
p. 99 - RÃconcilier emploi et environnement, sortir des dÃbats dâun autre temps
Corinne Morel Darleux
![-]() p. 103 - Quel mode de production Ãcosocialiste ?
p. 103 - Quel mode de production Ãcosocialiste ?
Mathieu Agostini
![-]() p. 112 - Plaidoyer pour lâaltermonde
p. 112 - Plaidoyer pour lâaltermonde
Jean Zin
Kit militant
![-]() p. 123 - Une alternative au consumÃrisme numÃrique
p. 123 - Une alternative au consumÃrisme numÃrique
Jean-FranÃois Rolez & Sarah Trichet-Allaire
Utopie(s) 2050
![-]() p. 128 - Lâutopie du collectif  un projet de DÃcroissance Â
p. 128 - Lâutopie du collectif  un projet de DÃcroissance Â
Lectures
![-]() p. 137 - A. MÃnster, V. Gerber & P. Greboval
p. 137 - A. MÃnster, V. Gerber & P. Greboval